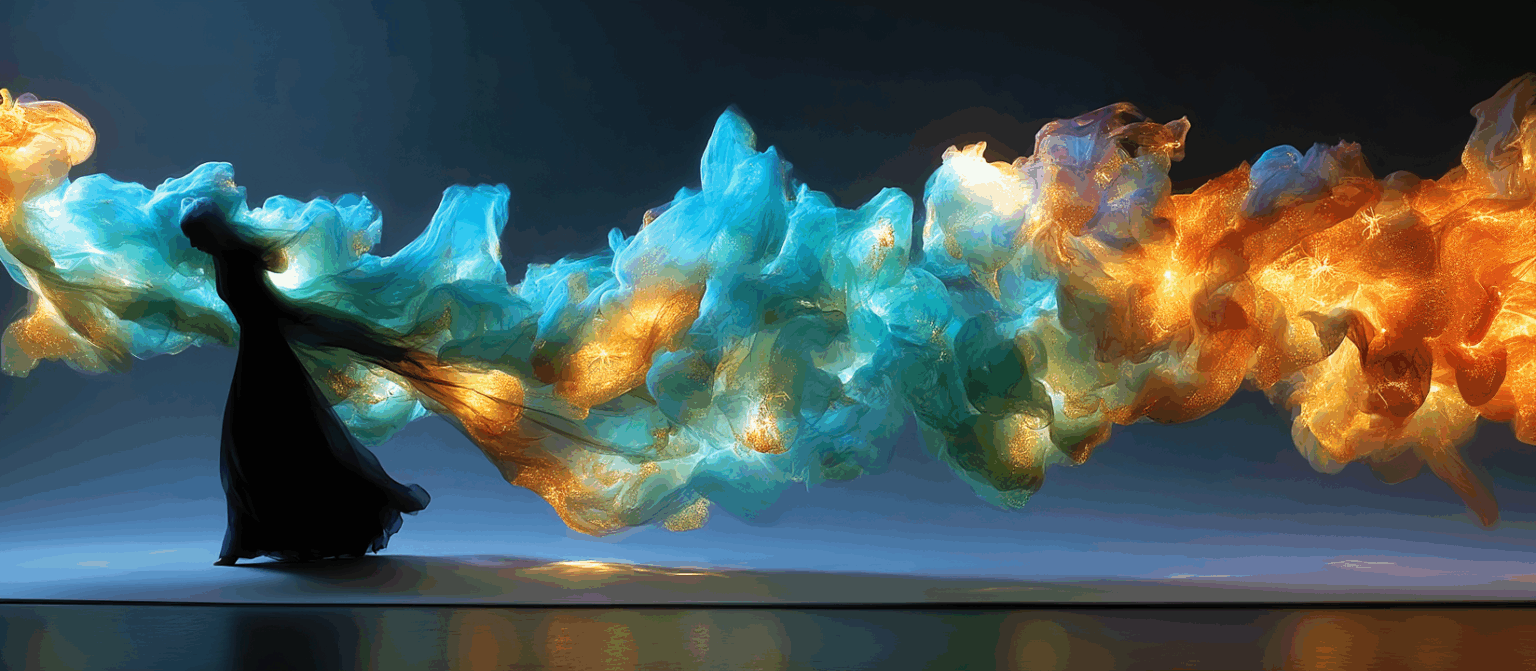
« Le degré de la lenteur est directement proportionnel à l’intensité de la mémoire ; le degré de la vitesse est directement proportionnel à l’intensité de l’oubli. » – Milan Kundera, La Lenteur, Gallimard, 1995
L’époque nous pousse au défilement. L’image, aujourd’hui, glisse plus qu’elle ne pèse. Or l’art, dans sa vocation plastique, résiste : il s’alanguit, il s’attarde, il traîne. Il nous impose une durée qui ne se contente pas de passer, mais qui insiste.
Lenteur : non pas inertie, mais densité. Non pas mollesse, mais pesée du temps dans l’espace.
Lenteur comme condition du regard
Le regard rapide capte une silhouette, le regard lent pénètre une présence. Là où l’œil pressé survole une toile de Rothko, il ne saisit qu’un carré de couleur ; mais celui qui s’y enfonce, longtemps, y découvre une chambre intérieure. La lenteur du regard transforme l’œuvre : elle n’est plus vue, elle est habitée.
C’est dans cette optique que le plasticien James Turrell plonge le spectateur dans des installations où l’on perd toute notion du temps – et c’est bien cela qui révèle l’essentiel : une conscience accrue de soi dans l’espace. L’expérience n’est possible que parce que l’artiste ralentit notre perception.
« Imprimer la forme à une durée, c’est l’exigence de la beauté mais aussi celle de la mémoire. » – Milan Kundera, La Lenteur, op. cit.
Kundera dit vrai : sans durée, pas de beauté. L’image qui ne dure pas est publicité. L’image qui résiste devient œuvre.
Pratiques lentes et œuvres méditatives
La lenteur ne se résume pas au regard : elle irrigue aussi les pratiques. Prenons Morandi : ses natures mortes, épurées jusqu’à l’obsession, semblent surgir d’un monde sans urgence. Chaque pot, chaque ombre y est déposée avec la déférence d’un moine devant son autel. Il peignait peu, lentement, recommençant souvent — non pour atteindre la perfection, mais pour extraire une présence.
Le Land Art, aussi, se déploie dans une temporalité non rentable. Andy Goldsworthy, agençant feuilles et cailloux à même la terre, sait son œuvre vouée à disparaître : mais sa lente exécution imprime une profondeur dans l’instant. Le fugace devient gravé, par la seule patience du geste.
« La patience nous sert contre les injures comme les vêtements contre le froid : si l’on multiplie les habits au fur et à mesure que le froid augmente, il ne peut nous nuire ; de même, il faut accroître la patience quand grandissent les offenses, et elles ne pourront blesser notre âme. » – Léonard de Vinci, Codex Arundel, folio 120r, British Library
Le peintre ingénieur nous livre là une sagesse du temps long : la lenteur est une force d’endurance, et dans l’acte plastique, elle devient même une forme de résistance.
Vitesse contemporaine et oubli du sensible
À l’inverse, notre époque carbure à la vitesse. Les images fusent, scrollent, s’effacent. Instagram a remplacé l’atelier. La production a supplanté l’invention. Il faut produire plus, plus vite, pour exister quelques secondes. L’image devient fluide, déliée de toute matière, de toute gravité.
Mais à quelle mémoire s’adresse-t-elle ? À quel corps ?
« Il y a un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l’oubli. » – Milan Kundera, La Lenteur, op. cit.
La vitesse tue le souvenir. Elle n’accumule pas : elle efface.
L’art, s’il veut survivre à cette amnésie technologique, doit réinvestir le champ du lent. Revenir au silence des pinceaux, à l’obstination de la main, à la durée de la contemplation. L’art qui prend le temps de se faire est le seul qui prend le temps d’être vu.
Sculpter le temps
Le philosophe Henri Bergson avait déjà pressenti cette plasticité du temps, qu’il appelait durée pure. L’artiste, à sa manière, sculpte cette durée. Non pas un temps horloger, mais un temps vécu, intérieur, étiré.
C’est cela que l’œuvre lente produit : un élargissement du sensible. Une intensification du vécu. Le plasticien devient horloger de l’âme.
Lenteur et art ne sont pas des jumeaux lents : ce sont des conjurateurs du vertige contemporain. Ils ne freinent pas pour ralentir : ils ralentissent pour révéler.
Conclusion : éloge de la lenteur, éloge du sensible
Le monde va vite. L’art, lui, va profond.
Reprendre possession du temps, voilà peut-être l’un des derniers luxes du geste artistique. Et si la lenteur est souvent perçue comme un défaut, elle devient, dans l’univers plastique, une qualité première. Elle est l’alliée du sensible, la condition de la mémoire, la signature d’un rapport authentique au monde.
« La lenteur est un refuge. Une manière d’habiter le temps. » – Pierre Tomy le Boucher, inédito.