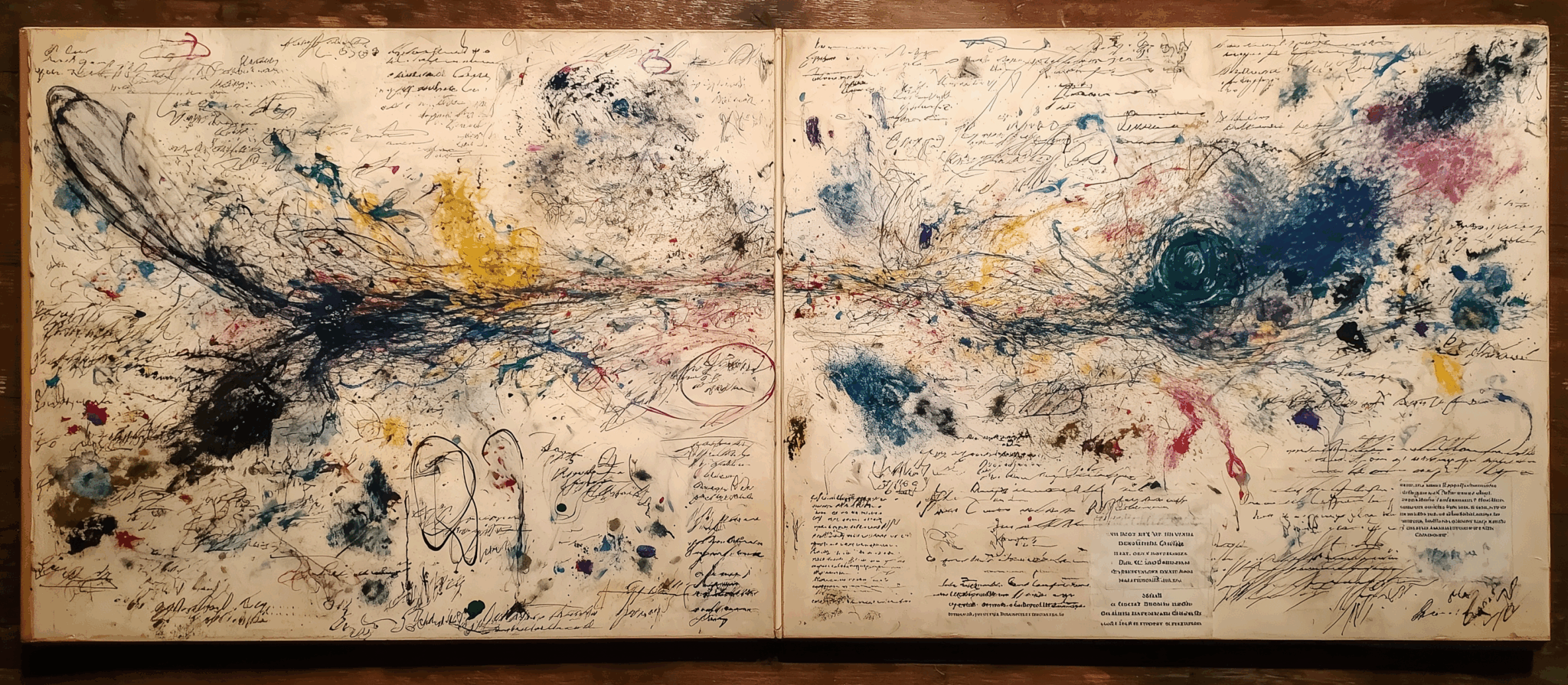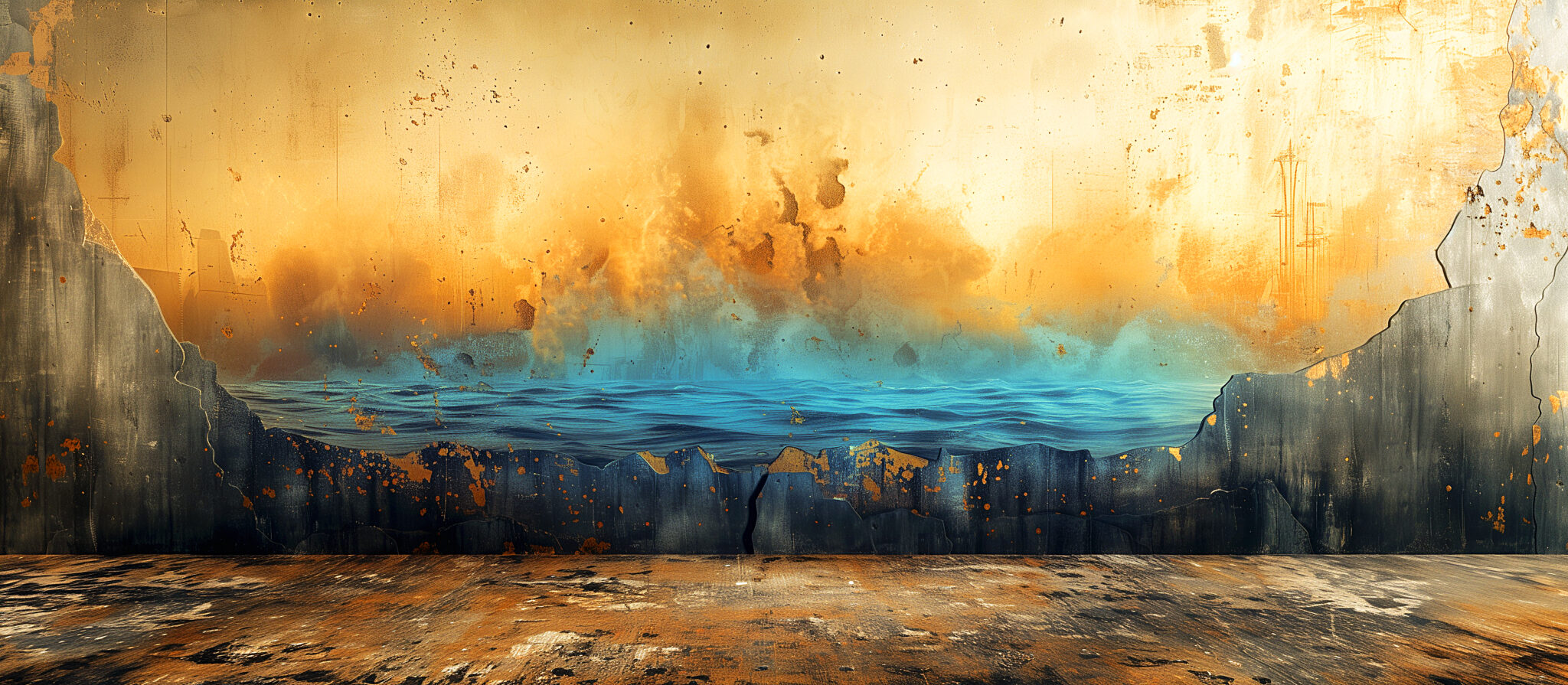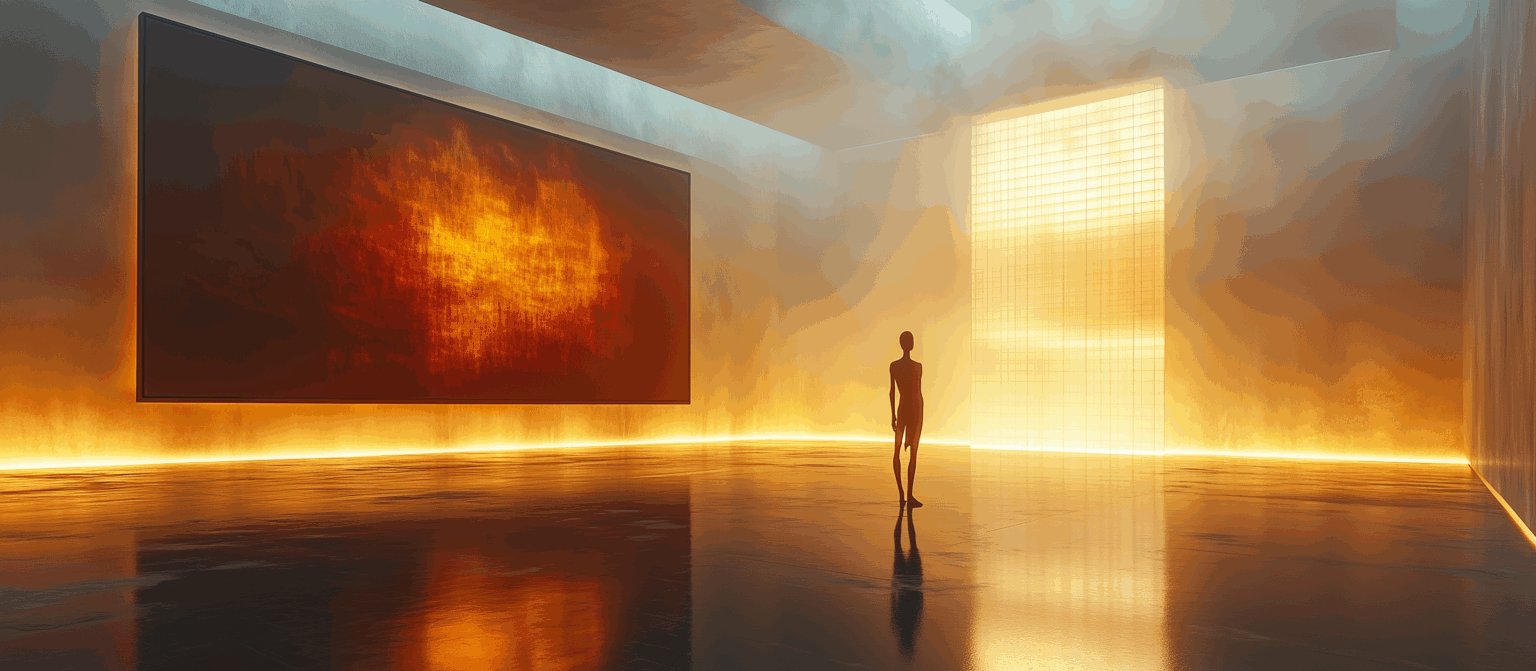L’oubli est un pinceau qui efface, mais aussi un burin qui sculpte. Sous son apparente négativité, il est un acte créateur : il choisit, trie, redessine. Oublier, ce n’est pas seulement perdre, c’est organiser autrement. En arts plastiques, l’oubli n’est pas l’ennemi de la mémoire, il en est la dramaturgie intérieure. Il donne forme à ce qui subsiste, et parfois donne sens à ce qui s’efface.
« Il peut aussi s’agir de fabulations de remémoration au cours desquelles les réponses fournies sont des souvenirs anciens et récents, parfois désorganisés sur un mode chaotique et mêlés d’événements imaginaires. » (Roger Gil, professeur émérite de neurologie, écrit dans Neuropsychologie, 8e éd., Elsevier – Masson, page 350)
Cette citation éclaire puissamment ce que vivent nombre d’artistes plasticiens lorsqu’ils tentent de capter une mémoire fuyante, ou plutôt une mémoire qui se raconte en se déformant. Le chaos de l’esprit devient alors le territoire fertile de la création.
Prenons Christian Boltanski : ses installations, faites d’archives recomposées, de photographies anonymes et de souvenirs flous, ressemblent à des mausolées de l’oubli. Elles ne commémorent pas un passé figé, mais rejouent l’incertitude de la mémoire humaine. Le flou, l’absence, le silence sont ses matériaux.
Autre exemple : Gerhard Richter et ses portraits volontairement floutés. Ces visages indistincts forcent le regard à se débattre avec un souvenir impossible, une image qui, à mesure qu’on la fixe, s’efface. L’oubli est ici texture picturale.
Dans une autre veine, l’art brut — celui des patients internés, des exclus, des marginaux — est souvent une tentative de fixer des fragments épars, des lambeaux de mémoire intérieure, comme si la création devenait un barrage contre l’effondrement de l’identité. Le psychiatre Hans Prinzhorn en fut l’un des premiers témoins. Jean Dubuffet, quant à lui, a su y voir une vérité plus radicale que celle de l’histoire de l’art officielle : celle d’une mémoire sans canon, sans repère, sans chronologie.
L’oubli, loin d’être un défaut, devient un procédé artistique : un filtre qui efface le superflu, une brume qui suggère plus qu’elle ne montre. Il autorise la métaphore, la perte de sens, le poétique. Il est, dans l’art, ce que le silence est à la musique : un espace vide, mais structurant.
Ainsi, les arts plastiques ne témoignent pas seulement de ce que nous retenons. Ils exposent, avec une poignante précision, ce que nous ne savons plus, ce que nous ne voulons pas savoir, ce que nous réinventons malgré nous. Ils sont les archives instables d’une mémoire chaotique, mêlée d’imaginaire — une mémoire qui, pour mieux survivre, accepte de se mentir.
Et l’oubli, ce trouble artisan, en est l’un des plus beaux outils.