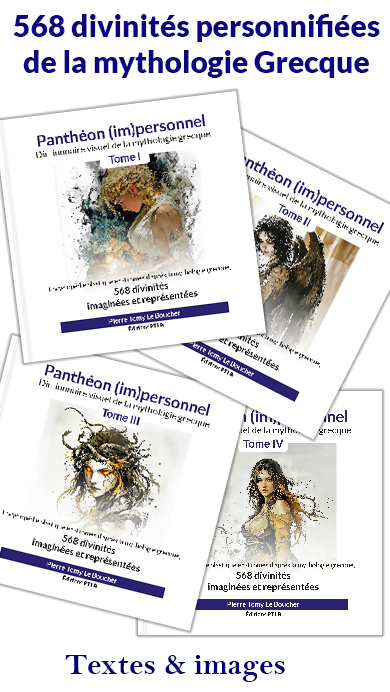La censure est facile à identifier lorsqu’elle vient de l’extérieur : une institution qui interdit, une règle qui encadre, une morale qui juge. Mais dans les arts plastiques, l’obstacle le plus déterminant n’est souvent pas celui que l’on voit. Il est intime. Il se glisse dans la pensée, dans le geste, dans la manière même d’aborder la feuille blanche. Cette forme intérieure de limitation, que l’on appelle autocensure, n’a pas besoin de justification extérieure pour exister : elle se forme dans le regard que l’artiste porte sur lui-même avant même de commencer à créer.
Une retenue qui se fabrique tôt
Dès l’enfance, on apprend qu’il y a des choses « jolies », « sages », « acceptables ». On apprend aussi à éviter ce qui dérange : trop violent, trop naïf, trop sensible, trop intime. Au fil du temps, ces jugements se déposent dans notre manière de faire. L’autocensure n’est donc pas un choix conscient. C’est une habitude. Une petite voix qui dit : « Ce n’est pas le moment », « On va se moquer », « Ce n’est pas bien fait ».
Dans les ateliers, cela se voit très vite.
Un élève efface sans cesse. Un autre fait des gestes minuscules. Un troisième demande tout le temps s’il fait « comme il faut ». Les œuvres n’avancent pas par manque de capacité, mais parce que la main a peur d’aller trop loin.
Un exemple courant : ne pas “faire trop”
Il existe un phénomène très répandu chez les étudiants en art : la peur de l’excès.
Ne pas mettre trop de couleur.
Ne pas représenter des corps trop expressifs.
Ne pas traiter des sujets personnels.
Cette retenue est souvent liée au désir d’être pris au sérieux. L’artiste redoute le jugement du spectateur ou du professeur, et il préfère alors se placer dans une zone neutre. Mais cette neutralité est rarement synonyme d’authenticité : elle est surtout une forme d’effacement.
Autrement dit :
L’œuvre n’échoue pas parce qu’elle est maladroite, mais parce qu’elle n’ose pas naître.
Quand le geste se ferme avant même d’exister
La grande particularité de l’autocensure est qu’elle précède parfois la pensée.
On ne se dit pas : « Je ne vais pas représenter cela. »
On ne l’imagine même pas.
L’autocensure réduit l’espace mental de ce qui est possible. Elle ne coupe pas l’œuvre ; elle coupe l’élan.
C’est par exemple le cas lorsque quelqu’un dit :
« Je n’aime pas dessiner les mains, alors je cache les mains. »
Ce n’est pas de la pudeur, c’est une stratégie de survie contre le risque du ridicule.
Ou encore :
« Je ne parle pas de ma famille dans mon travail, c’est trop personnel. »
Alors même que ce sujet est peut-être le cœur de ce qui appelle une expression.
Certains artistes affrontent l’autocensure en surface
Beaucoup d’artistes contemporains travaillent précisément à partir de cette tension.
- Louise Bourgeois revient toute sa vie sur les figures du corps maternel, non parce qu’elle veut tout raconter, mais parce qu’elle refuse de cacher ce qui la constitue.
- Ai Weiwei transforme le rapport au politique en geste artistique, non pour provoquer, mais pour éviter de se taire.
- Basquiat joue avec les stéréotypes sur son identité plutôt que de les subir. Il les expose, les détourne, les force à se montrer.
Ces artistes ne cherchent pas « la liberté totale ». Ce serait une illusion.
Ils cherchent l’honnêteté du geste.
Ils tentent de reconnaître ce qui les retient, pour décider s’ils veulent s’y soumettre ou le dépasser.
La peur du regard des autres
L’autocensure est presque toujours liée à la peur d’être vu.
Créer, c’est assumer une exposition. Cela implique d’anticiper le jugement, même silencieux, d’un spectateur. Il n’existe pas d’œuvre totalement détachée du regard d’autrui.
Le problème n’est donc pas de se demander comment éviter cette peur.
Elle fait partie du processus.
La question est : comment continuer malgré elle ?
L’artiste apprend progressivement à reconnaître l’instant où il commence à se retenir. Ce moment est très subtil : c’est souvent une contraction dans le corps, une respiration courte, un changement dans le geste. Il se produit lorsque l’œuvre devient risquée, lorsqu’elle touche à quelque chose d’essentiel.
C’est précisément là que le travail commence.
Créer sans se libérer de tout, mais en choisissant
Il ne s’agit pas de produire sans filtre.
Cela n’aurait rien d’artistique.
La création demande de la sélection, de la précision, de la retenue quand elle est choisie.